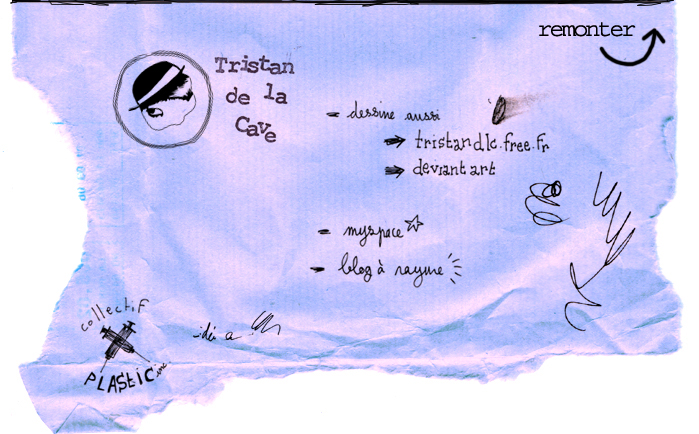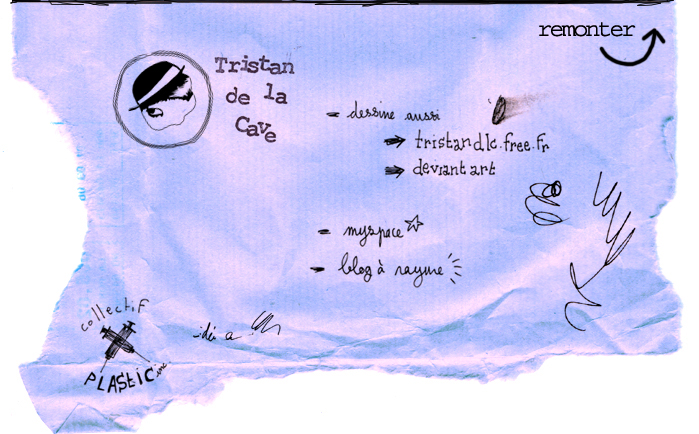| |
Lobotomie papa, lobotomie maman.
Il y en a bien un qui va encore dire que je suis fou ; et à celui-là, je lui répondrai que non, pas du tout, mais alors que je ne suis pas du tout, pis, que je suis peut-être même bien moins fou que lui. Est-ce clair ? Je précise parce que ça, c’est évident, c’est quelque chose de trop récurrent pour être occulté, il y en a toujours un pour dire que je suis fou et celui qui dit ça, c’est peut-être le plus fou. C’est tout comme le Diable, n’est-ce pas, il est le premier a dénoncer le mal de sa longue main rouge alors que le mal, eh bien c’est lui, lui tout seul, rien que lui. Est-ce clair, hein ? Moi, je tiens à ce que ce soit clair et qu’il n’y ait pas de quiproquo sinon, je vous le jure, je suis prêt à me percer les yeux sur place avec mes propres ongles.
Voilà, c’est dit, messieurs et peut-être bien mesdames, aussi. C’est dit, j’insiste, j’insiste lourdement quitte à être insupportable – ça, c’est rien qu’un détail, bien sûr que je suis insupportable et même si je fais tout pour ne pas l’être, eh bien je le suis quand même. Vous le croyez, vous, que je dise une chose pareille ? Bon, tout ça, ça n’est pas si important, tout le monde s’en moque, et moi le premier.
Venons-en aux faits.
J’avais été embauché dans une agence, une agence de télémarketing. Vous savez ce que c’est, ça ? Au cas où il y ait des gens, là-bas, au fond, qui ignoreraient ce que c’est, eh bien je vais me faire le plaisir de leur expliquer de quoi il s’agit.
Imaginez une pièce, une grande pièce, constellée de longs bureaux ; et ces bureaux, séparés à distance égale, par des vitres, ce qui forme donc des petits bureaux individuels. Sur ces bureaux individuels, il y a des ordinateurs et devant les ordinateurs, il y a des gens. Imaginez ensuite qu’il y ait cent personnes dans cette pièce, attablées devant leur ordinateur, affublées d’un joli couvre chef – en fait, il s’agit de casques équipés de micro, n’est-ce pas. Bon et tout ces gens, ils parlent en même temps alors ça vous fait un de ces brouhahas pas croyables, un grondement hallucinant, continu, qui devient presque inaudible puisqu’il est constant. Vous savez, n’est-ce pas, ce que j’essaie de signifier là ? Eh bien qu’on s’habitue tellement à ce grondement sépulcrale, on s’y habitue tant et si bien qu’ensuite, on finit par ne plus l’entendre. Ah, mais l’habitude, c’est une horreur ! Parce que ce brouhaha, en fait, c’est pis que dans un hall de gare, ça vous prend les tripes et ça vous les retourne, ça fait vriller votre cervelle et ça brise vos tympans.
Et ces cent personnes, eh bien, elles appellent des gens, des pauvres gens, tristes à crever, qui n’ont bien évidemment rien demandé et ce, pour tenter de leur vendre je ne sais quoi pour je ne sais quel prix. Oui, messieurs, oui, vous en pensez quoi, vous, de tout ça ? Moi, ça me fait vomir mes viscères honteux. Parce que oui, il n’y a pas de quoi être fier, bien au contraire ! Et j’en ai honte, j’ai honte, pis, pis, j’en ai honte parce que j’ai choisi de le faire. Bon, comme ça, je pourrai dire que je l’ai fait par manque d’argent, que je n’avais plus un kopeck en poche, que je l’ai choisi consciemment et même là, même avec cette idée en fait, en réalité, je serais capable de dire qu’on m’y a forcé, triste vie de chien, qu’on m’y a forcé, qu’on m’a placé sur un siège, dans une petite cage vitrée et qu’on a mené mon discours à la baguette. Tout ça, bien évidemment, ce serait un mensonge, j’ai choisi d’être assis sur ce siège, entouré de deux vitres. Bon, gardez bien ça en mémoire puisque je ne le répèterai pas – très certainement par manque de courage.
Ensuite, imaginez-moi affublé du joli couvre-chef, à parler dans mon petit micro de rien, entouré de 99 personnes tout comme moi, avec leur casque sur les oreilles. Des personnes méprisables comme ce n’est pas permis. Des imbéciles heureux, des crétins – jamais je n’ai pu penser du bien d’eux où si ce fut le cas, c’était par faiblesse d’esprit, durant quelques secondes. C’est tout. Parce que moi aussi, parfois, je peux être faible d’esprit, n’est-ce pas, c’est humain, n’est-ce pas que j’ai raison, sentir son esprit flancher un peu et s’émouvoir d’un petit rien ?
Passons.
— Oui, bonjour monsieur, je suis X du service client Tralala.
Là, maintenant, je me coupe moi-même ; non pas que je m’appelais X, non (on a pas idée d’appeler quelqu’un X) ; c’est juste qu’ici-bas, tout le monde s’appelait X, n’est-ce pas. Tous les jeunes hommes s’appelaient X et toutes les jeunes filles s’appelaient Y, c’était ainsi, on ne pouvait rien y faire. Maintenant que les présentations sont faites, je peux continuer.
— Oui, bonjour monsieur, je suis…
Et là, je me coupe de nouveau. Bien, il ne faut pas dire “oui”, c’est mal, ce n’est pas commercial, il ne faut pas dire oui et se débarrasser de ce tic encombrant que les trois quart de la population a, accroché au bord des lèvres. Ainsi, je disais :
— Bonjour monsieur, je suis X du service client Tralala.
C’est très bien, c’est très bien.
Et même si je n’avais pas du tout envie de faire ce que j’étais en train de faire, même si ces paroles déformaient mon visage à coups de grimaces, même si j’en vomis encore de honte, oui, oui, eh bien il fallait sourire, être radieux et montrer ses dents à un interlocuteur qui était peut-être à mille lieue de mon sourire denté. Oui, oui ! Dans ce monde d’hypocrisie ambiante, j’excellais. Oui, oui, juré ! J’excellais parce que mon sourire, je pouvais le forcer, qu’il ait l’air vrai, d’une sincérité troublante, mais qu’il soit, en réalité, tellement faux, comme un sale dentier aux dents gâtés et pourris. Alors mon sourire radieux aux mille dents blanches, je le dévoilais constamment, il ne me quittait plus ; et même en cas de reproches, des pires reproches, en cas d’injure, je montrais ce sale sourire. Et voilà qu’on me rabaisse, qu’on me ramène dans la boue et voilà que je souris, de ce sourire figé, bienveillant et sournois… Mais oui, mais oui ! Et ça, les gens, ça les étonnait toujours, que je puisse sourire même avec un fouet juste au dessus du dos, ça les étonnait puis ça les déstabilisait, n’est-ce pas et moi, comme ça, j’en gagnais non pas en crédibilité (quelqu’un qui rit sous la douleur n’a absolument rien de crédible) mais en prestance. Oui-oui, j’en gagnais en prestance et mon interlocuteur, il se retrouvait soudain tout désarçonné, pantois et éperdu et tout ça, ça me faisait rire encore plus.
Passons.
Ainsi, avec mes “bonjour monsieur, je suis X du service client Tralala” je passais pour un crétin fini – mais n’était-ce pas là le but ? On me dit qu’il faut bien répéter ce qu’on m’a dit, qu’il faut le répéter mot pour mot sinon c’est la baguette sur les doigts, sinon c’est l’ombre du “superviseur” (entendez par là le “supérieur”) qui pèse lourdement sur la nuque. Et ça, je n’en voulais pas, de cette baguette sur mes doigts ni même de cette ombre sur ma nuque qui me faisait suer – non, non ; moi, je voulais juste les sourires approbateurs. Alors je répétais mes “bonjour, monsieur” comme il se doit et des sourires approbateurs j’en avais à la pelle. Malgré tout, il y avait toujours une objection qui surgissait de nulle part.
— Hum … mmmoui, ton bonjour, pourrait-il être plus rapide tout en étant plus lent ? me disait-on.
— Bien monsieur, oui monsieur, tout à fait monsieur, comme bon vous…
— Tu peux me tutoyez me répondait-on immédiatement.
— Comme bon te semble, monsieur.
Bien, on pouvait tutoyer ses supérieurs, n’est-ce pas, ce n’est pas moi qui l’ai dit. On pouvait, croyez-le, on pouvait même plaisanter avec eux et se moquer de la petite bonne femme qui restait toujours dans son coin avec ses sourcils en broussaille et son épis sur le crâne et ses trois dents en moins, n’est-ce pas, et toujours avec un sourire narquois et des yeux brillants n’est-ce pas. Mais ces mêmes supérieurs avec qui vous aviez eu la larme à l’œil vous poignardait ensuite, lorsque vous étiez de dos. Amusant, n’est-ce pas. Alors moi, comme un crétin fini, avec mes “bonjour monsieur”, je me suis aussi mis à plaisanter joyeusement, avec toute la bonhomie du monde avec mes supérieurs et à les poignarder dans le dos et tout ça, avec un sourire narquois au coin des lèvres – parce que les sourire narquois est toujours de rigueur.
Peut-être bien que c’est partout pareil, qu’on tutoie à tout va, qu’on s’amuse dans la joie et la bonne humeur et qu’on fête cette joyeuse bonhomie dans une mare de sarcasmes et de sang ranci. Peut-être bien, qu’en sais-je.
Bien que je sois un de ces insoumis, que j’aie le système hiérarchique en horreur et bien que ces seuls mots me rendent malade et me fassent vomir, j’obéissais à la lettre ; je faisais ce qu’on me demandait de faire et pire, je le faisais avec zèle. J’arrivais toujours une heure en avance, quitte à me lever la nuit et j’exécutais tous les ordres avec sourire et docilité. L’insoumis s’était-il soumis ? Non, non, messieurs et peut-être mesdames, pas une seconde, pas une seconde. L’insoumis était toujours insoumis et se soumettait non pas par déplaisir ni par plaisir d’ailleurs… mais plutôt par “vengeance”. Ça, je le sais, c’est assez incompréhensible. N’empêche, moi tout seul, comme ça, eh bien j’avais compris que l’obéissance était une puissance et ça, je le dis, quitte à me mettre tous les insoumis à dos.
J’étais, en effet, un employé modèle, le plus irréprochable, le plus docile, le plus obéissant et surtout… j’étais le plus vil et dans un sens, le plus détestable. Et pourquoi Diable dis-je une telle chose ?
Eh bien tout en détestant ce que je faisais, tout en détestant les gens qui me donnaient des ordres, tous en détestant mes collègues de travail, tout en détestant même le moindre objet qui m’entourait là-bas, tout en détestant les murs, le sol, l’endroit en lui-même, je feignais l’impassibilité la plus totale. On admirait mon calme, mon obéissance, mes supérieurs me louait et mes comparses me détestaient parce que eux, eh bien ils n’avaient rien compris. La différence entre eux et moi, c’est que eux crachaient leur dépit ouvertement, sans vergogne, qu’ils le faisaient sans peur tandis que moi, je crachais mon dégoût lorsque tout le monde avait le dos tourné parce que j’étais un sale petit couard. Bon, mais moi, je savais utiliser les bonnes manières et je maîtrisais l’hypocrisie à merveille.
Bref, en quelques mots, tous en détestant ce beau monde, j’étais prêt à lécher tous les pieds du monde, à lécher les talons les plus sales et les orteils les plus malodorants et ce le plus impunément du monde.
Je dis que je faisais ça impunément mais il ne faut pas non plus penser que je n’en avais pas honte. Bien sûr que j’avais honte ! J’avais honte, terriblement et c’était peut-être aussi pour ça que j’exécutais toutes ces obséquiosités puantes, ces gestes déplacés, toutes ces choses qui faisaient de moi un homme, en apparence, soumis. Je léchais les pieds des gens que je détestais le plus – ne s’agit-il pas là d’un fameux comble ? Moi-même, je me montre du doigt en me demandant comment on peut avoir aussi peu d’amour propre pour soi-même. Pourtant, de l’amour propre, j’en avais à la pelle, mais on verra ça plus tard. Bref, je disais que moi-même, je me montrais du doigt et même, je huais mon comportement. Que croyez-vous donc ? Mais oui, je suis le premier à me dénoncer, à monter sur l’échafaud, à me mettre à genoux et à placer ma tête sous l’échafaud.
Tout ça, peut-être bien que c’était juste pour me donner un genre. Moi, au fond, tout ça, je m’en moquais terriblement, c’était comme trop insignifiant, trop inconsistant, comme si je donnais un peu trop d’importance et à des choses qui ne le méritaient pas. Oui-oui, au fond, je m’en moquais comme de mes premières chaussettes mais n’empêche, je faisais comme s’il s’agissait de quelque chose qui me tenait à cœur.
Bref ! Mes journées, je les passais assis, dans ma petite cabine, entouré de deux vitres, le casque rivé sur les oreilles, pour proposer à des gens d’acheter mon fabuleux, incroyable, mon produit qu’il faut avoir si on veut être dans le vent et si on veut briller en société.
— Le produit créer le besoin – et non pas l’inverse.
Ce fameux aphorisme n’est pas de moi. Non, non, moi je ne suis pas capable de sortir des inepties pareilles. Ce fameux aphorisme sort tout droit de la bouche d’un de mes “sup” – oui, parce qu’ici-bas, on parle par abréviation, ça aussi ça donne un genre, ça donne même l’impression que les superviseurs sont des amis ; ainsi, ils pourront poignarder encore plus facilement dans le dos et arracher la colonne vertébrale à la main, sans qu’on réalise quoique ce soit, n’est-ce pas.
— Bonjour monsieur, je suis X du service client Tralala.
J’ai dit monsieur, mais il s’agissait d’une madame ! La faute à qui ? Sur mon écran, il est écrit “monsieur”. Bon, une pirouette, une obséquiosité dégoulinante et voilà que je retombe sur mes pattes.
— Hum-hum, bonjour madame, je suis X du service client Tralala… Vous êtes bien Madame Desvilles ?
— Oui, oui, c’est bien moi.
— Bien, bien, je vous appelle aujourd’hui afin de vous faire part d’une offre exclusive, on ne peut passer à côté, n’est-ce pas madame.
— …
— D’accord, madame !
Interception de l’ombre qui pesait sur la nuque, elle secoue mon épaule et me répète une centième fois qu’il ne faut pas dire “d’accord”, que ce n’est pas très commercial, qu’il faut dire autre chose, qu’il faut dire “très bien” par exemple.
— Eh bien madame, écoutez donc ce que j’ai à vous proposer aujourd’hui, dis-je ensuite, quelque peu chamboulé
— Je n’ai pas le temps, je n’ai pas le temps, pas le temps.
— Très bien madame Desvilles, je comprends.
Je note au passage que l’empathie est vraiment recommandée. Plus on dit de “je comprends” plus on monte en grade dans l’estime des “supervieurs”
— Bien madame Desvilles, je comprends, mais écoutez donc ce que j’ai à vous proposer. Madame Desvilles, une offre incroyable, exclusive, qu’il ne faut pas laisser filer, madame.
— Je n’ai pas le temps, je n’ai pas le temps, au revoir monsieur.
Puis s’ensuite un bip-bip téléphonique, un néant absolu. L’ombre qui pèse sur ma nuque pèse encore plus durement, je la sens ostensiblement alors pour ne pas voir les yeux grondants, je ne me retourne pas mais les yeux grondants grondent sourdement, s’infiltrent tout au fond de mon crâne et c’est malgré moi que je me retourne avec mon sourire placardé aux lèvres.
— Eh bien, me dit l’ombre aux yeux grondants, ne laisse pas passer, accroche-toi, sois plus souriant ; bien évidemment ne force pas la cliente, il ne faut pas la forcer sinon elle portera plainte auprès du service Tralala.
— D’acc… Bien, très bien, très bien, je réponds en souriant.
— Tu gardes le sourire, c’est déjà ça !
— Très bien, très bien, très bien !
— Lance un nouvel appel.
— Très bien.
Avec mon sourire figé aux lèvres, je m’exécute.
— Bonjour madame, je suis X du service client Tralala.
— J’suis point une m’ame, me répond-t-on lointainement.
— Bonjour monsieur (j’appuie bien sur le “monsieur”), je suis donc X du service client Tralala. Je souhaite parler à monsieur Deschamps.
— J’suis ben m’sieur Deschamps, qué qu’vous voulez ? Qui donc qu’vous’êtes ? Ghhgehhah…
Je n’ai pas compris ce qu’il me disait.
— Je suis X du service client Tralala – je répète.
— Qoué ?
— Je suis X du service client Tralala.
— Quéssecé ça, qué le service client Tralala.
— Je suis donc X du service client Tralala.
— Et qué qu’vous voulez avec vot’ service Tralala.
— Je vous appelle aujourd’hui afin de vous faire part d’une offre exclusive, on ne peut passer à côté, n’est-ce pas monsieur. Une offre exclusive, incroyable, en série limitée, que vous ne pourrez pas trouver ailleurs, monsieur Deschamps. Et aujourd’hui, je vous permets aimablement de bénéficier de cette nouvelle offre exceptionnelle. Une nouvelle offre exclusive, en série limitée, qui vous permettra de faire des économies.
Mais Diable ! Je parle, je parle et plus personne n’écoute ! Monsieur Deschamps n’est plus là, disparu, volatilisé, il n’est plus là et plus personne n’écoute ce que je dis. Mais Diable, Diable, rougissant de dépit, je me retourne – l’ombre pesante à elle aussi disparue. J’ai pris un papier, les recommandations à suivre à la lettre et je l’ai relu une centième fois. Ce qui signifie, oui-oui, que je l’avais déjà lu 99 fois alors pourquoi donc le relisais-je encore une fois alors même que je connaissais déjà toutes ces recommandations par cœur ? Eh bien, je suppose que tout le monde connaît ça, il s’agit simplement de “faire passer le temps”… passez-moi l’expression. Bon, il s’agit de rendre chaque action élastique pour qu’elle prenne le plus de temps et qu’elle me laisse le moins de temps possible pour travailler. Je faisais ainsi durer les actions les plus insignifiantes, les plus minuscules afin qu’elles s’étalent le plus longtemps possible dans le temps. Je mettais une éternité à choisir une place, je mettais une autre éternité pour m’asseoir ; l’installation de mes petits papiers sur mon bureau me prenait une autre éternité et mettre mon couvre-chef sur les oreilles me prenait encore une autre éternité. Avec un peu de chance, cinq pleine minutes s’écoulaient (voyez que la notion d’éternité, dans ces cas-là est tout à fait particulière, n’est-ce pas). Bien sûr, il arrivait qu’un supérieur vienne me tirer les oreilles, vienne me ramener à ma tâche et vienne me plaquer la tête contre l’écran de l’ordinateur alors moi, dans ces cas-là, voilà que je décochais mon sourire approbateur et voilà que je sortais ma langue prête à lécher les pieds les plus sales. Alors quoi ? Alors les reproches se radoucissaient, les yeux s’éclaircissaient et l’orage partait un peu honteux, sur la pointe des pieds et bon, moi, je triomphais méchamment, avec cette fois-ci, le fameux petit sourire narquois au coin de la bouche.
Je détestais tous mes collègues et pourtant, je ne leur cherchais jamais de noises, c'est-à-dire que je les détestais dans le silence le plus absolu et dans l’impassibilité la plus hallucinante. Lorsqu’ils me parlaient, je leur répondais poliment et même, je leur répondais avec mon sourire approbateur, grand comme dix sourires réunis. Je ne comprenais pas pourquoi je devais supporter tous ces imbéciles sur patte et pourquoi je devais nécessairement m’adresser à eux alors même que j’étais là simplement pour “gagner ma vie”, non pas pour être un monument de sociabilité. C’est pourquoi il m’arrivait de m’en tenir au minimum nécessaire, de dire un “bonjour”, un “au revoir”, de répondre “oui” ou bien “non” aux questions et de m’éclipser dans un coin – voilà tout.
Il y avait un fossé infranchissable entre ces gens et moi. Une première impression qui se renforçait de jour en jour
Lorsqu’ils réussissaient là où je ne réussissais pas du tout, c'est-à-dire que lorsqu’ils accomplissaient des taches dignes d’un enfant de 5 ans et lorsqu’ils les accomplissaient avec succès tandis que moi, ces taches dignes d’un enfants de 5 ans, je ne les accomplissais pas du tout avec succès, dans ces cas-là, je me sentais comme un cafard à côté d’eux – ou bien, pis, pour rehausser mon estime laminé, je me mettais à penser que j’étais nettement plus intelligent qu’eux (je pensais ça au mot près) puisqu’ils réussissaient là où l’intelligence et la force de l’esprit n’étaient pas pris en compte, pas utilisés, pas même frôlés.
Lorsqu’ils faisaient huit ventes dans la journée et que je n’en faisais même pas une minuscule, je rougissais de honte et d’humiliation et la bave au coin des lèvres, je les regardais briller ; moi, j’avais juste envie de me lever pour en coller une belle aux vainqueurs de la journée. Chaque fois que l’un d’entre nous réussissait une vente, il se levait prestement pour mettre un petit bâton à côté de son prénom sur un tableau qui trônait au centre de la pièce. Et voilà qu’un heureux imbécile a réussi une vente, il se lève, bombe le torse, lève le menton, sourit en coin et se dirige à grandes enjambées fières vers le tableau et vlan, un trait à côté de son prénom et vlan, un sourire d’un supérieur en réponse à l’heureux élu et vlan, vlan voilà qu’il fait son coq. Je surveillais les allers et les venues du coin de l’œil et je frémissais dès qu’un de mes collègues se levait. J’en venais même à frapper du poing sur la table, de colère de voir les autres vendre tandis que moi, moi, je ne vendais rien – et voir mon prénom, sans petit trait pour le rehausser, me rendait fou de rage.
Parce que la vérité… la vérité, c’était que j’étais un bien piètre vendeur ! Les seules ventes que je réussissais, je les faisais auprès d’alcooliques saouls comme pas deux, auprès de pauvres ménagères au bord de la fenêtre ou bien auprès de pauvres garçons qui avaient déjà la corde autour du cou, prêts à se jeter de leur tabouret.
J’étais un piètre vendeur alors pourquoi Diable me gardaient-ils ? Pourquoi Diable ne me jetaient-ils pas dehors à coups de pied dans le derrière ? Eh bien, c’est assez simple… Avant de se faire embaucher, tous les employés avaient dû subir un “test psychotechnique”, vous voyez le genre, n’est-ce pas, avec tous un tas de questions vicieuses pour savoir si vous être sain ou complètement dérangé, pour savoir si vous êtes un homme prêt à se damner pour la vente ou bien prêt à vomir sur votre société etc. Bon, et moi, je n’avais eu que des “bonnes réponses”, j’entends par là que mes résultats étaient ébahissant, troublants, en ce sens où le test psychotechnique disait de moi que j’avais une véritable aptitude à la vente, que j’avais l’esprit commercial, que j’étais d’une sociabilité à toute épreuve, que je savais être ferme, que je savais faire preuve de directive, que je savais être convaincant, que je bénéficiais d’une parfaite maîtrise de moi etc… Bref, on se demande où ils vont chercher tout ça.
Et le fait est que dans ma société, ils font plus confiance aux résultats d’un test psychotechnique, qu’aux nombres de vente alors moi, avec mes deux petites, ridicules ventes de rien du tout dans la journée, je pourrai bien leur donner des envies de licenciement… Mais… mais j’ai des résultats de test psychotechnique qui ne donnent pas des envies de licenciement ! Vous comprenez ça, vous ? Eh bien, que malgré mes faibles ventes, eh bien, ils attendaient quand même un redressement de situation, un changement total puisque j’avais réussi mon test haut la main !
Mais les pauvres gens, les tristes gens, eh bien ils pouvaient attendre longtemps, n’est-ce pas, parce que moi, n’est-ce pas, j’avais triché à leur test, j’avais triché, et bien comme il faut, comme un sale fat, un sale porc ! Oui, oui ! j’avais triché impunément – et puis après tout, qui ne triche pas, n’est-ce pas ? Bon, j’avais répondu tout ce qu’il fallait bien réponde, inutile d’avoir une cervelle bien remplie pour savoir ce qu’il faut répondre et voilà.
Et encore, moi, je répondais à leurs questions stupides et je riais grassement et j’ai ri encore plus lorsqu’ils ont annoncé les résultats de mon test parce que je savais que j’avais triché et que tout ça, c’était juste une ignoble mascarade, un mensonge tellement grossier que je ne comprenais pas qu’ils ne puissent pas ne pas saisir l’immense supercherie ! Il fallait vraiment être un crétin fini pour ne pas comprendre. Or, à mes yeux, le monde entier était un gros crétin fini – sauf moi ; et tout ça, bon, moi, ça me faisait rire grassement, voyez-vous. Mais tout de même, parfois, moi aussi je me prenais pour un crétin fini tandis que je considérais le monde entier comme une intelligence inaccessible.
Bref. Maintenant vous savez pourquoi je n’avais pas encore eu de coup de pied au derrière avec un poing levé dans le dos et un petit mot de licenciement. Tout ça, c’était assez amusant, je l’ai déjà dit et je le dirais encore, tout ça, que je riais grassement parce que je n’étais qu’un sale charlatan et que mon charlatanisme, il faisait marcher tout le monde, il faisait marcher le monde entier, comme un seul homme.
Passons.
Et revenons-en aux “bonjour monsieur, je suis X du service client Tralala.” Il me semblait que je ne savais plus rien dire d’autre, que mes répliques quotidiennes se réduisaient à d’imbéciles “bonjour je suis X du service client Tralala” et ainsi de suite. Bref ! Il me semblait que je n’étais plus capable de dire autre chose, de dire un “bonjour” à ma boulangère sans rajouter le fameux épithète du “je suis X du service client Tralala” ce qui donnait des répliques assez intéressantes du genre :
— Bonjour monsieur la boulangère, je suis X du service client Tralala et je souhaiterai ardemment que vous me fassiez profiter de votre toute nouvelle offre exclusive, à savoir votre toute nouvelle baguette Untelle au prix très économique de tant. Je vous remercie madame, j’espère que vous avez été satisfaite de mon appel, je vous remercie de votre accueil et je vous souhaite une excellente journée.
Parce que cette dernière phrase, cette horrible phrase pompeuse comme pas permis, n’est-ce pas, eh bien elle aussi il fallait la déclamer, coûte que coûte.
Mais plaçons-nous en situation.
— Bonjour monsieur, je suis X du service client Tralala et je souhaite parler à monsieur Untel.
— Je suis monsieur Untel.
— Très bien monsieur Untel je vous appelle aujourd’hui afin que : offre exclusive, bénéficier, offert, cadeau, prix, série limitée et tout le toutim.
— J’ai pas le temps m’sieur du service client Tralala. Allez donc vous faire voir là-bas, allez donc voir s’y j’y suis monsieur, fichez-moi la paix, en d’autres termes : laissez-moi donc tranquille.
— Monsieur, je répète : offre exclusive, séries limitée etc. – attitude commerciale, commerciale, commerciale.
— Espèce de raclure ! Qu’est-ce que vous avez à me harceler au téléphone ! Quinze fois d’affilée qu’il sonne ! Alors supprimez mon numéro de votre base de donnée et fichez-moi donc la paix, espèce de crétin, raccrochez, laissez-moi ! Adieu ! …
— Eh bien monsieur j’espère que vous avez été satisfait de mon appel, je vous remercie de votre accueil chaleureux et je vous souhaite une excellente journée.
Alors moi, avec votre “merci pour votre accueil”, je passe pour un imbécile, n’est-ce pas. Mais peu importe, il faut la dire cette phrase pompeuse, il faut la dire quitte à passer pour un imbécile. Tout ça, cette histoire de passer pour un imbécile, ce n’est pas grave du tout, il faut passer outre ou bien pire : il faut s’y habituer. Moi, je déteste passer pour un imbécile, voyez-vous, alors quoi, il fallait bien serrer les dents, aïe-aïe – merci l’estime de soi ! Encore, parfois, je l’avoue, j’y prenais un malin plaisir, à tout ça, à l’injure, à l’attaque et tout en y prenant plaisir, je sentais un sale goût amer percer mon palais et s’insinuer dans ma gorge. Ensuite, il faut recommencer, il faut reprendre les “je suis X du service client Tralala”, n’est-ce pas. Il faut recommencer une fois, deux fois, cent fois, mille fois ! Bon, la lassitude, on la connaît, on l’enchaîne à soi et on se l’approprie.
Bon, ce genre de personne, il y en a, des mégères ou bien des bonhommes las qui vous jettent tout leur agacement à la figure – dans ce genre de cas, il faut cocher, sur l’ordinateur, une case précise, n’est-ce pas ; une case : dialogue impossible. Bon et moi, exprès, lorsque je tombais sur ce genre de personne, exprès, je ne cochais pas “dialogue impossible”, je relançais l’appel, appel qui arrivait un peu n’importe où, chez un collègue de travail, n’est-ce pas, exprès pour que lui aussi se prenne ces saletés d’injures dans les oreilles parce que les appels étaient informatisés et automatiques, voyez-vous.
Bref. Tout ça n’empêchait pas mon prénom d’être dénué de petits traits flatteurs.
Alors moi, je me suis dit qu’il fallait s’accrocher au client, qu’il fallait s’y accrocher fermement et ne plus le lâcher, s’enrouler autour de ses jambes et se dérouler lorsqu’il aura acheter mon satané produit. Parce que mon satané produit, n’est-ce pas, il en a réellement besoin, je veux dire, c’est essentiel à sa survie et par ailleurs, il s’agit d’une offre exclusive, n’est-ce pas, on ne peut pas décemment passer à côté.
Pourtant, le produit que je vends, je sais pertinemment qu’il est futile, qu’il est inutile, bref, qu’il ne sert à rien et pis, qu’il est cher – cher et inutile, amusant, n’est-ce pas. Moi, même sous la menace du couteau, je ne l’achèterai pas ce satané produit inutile et cher, c’est dire. Mais attention, là aussi je dois me couper, me retenir parce que le petit nabot, celui qui est hiérarchiquement au-dessus de moi, celui qui est tout petit, tout petit et celui qui a une voix portante, il l’a dit n’est-ce pas, oui-oui, il a dit :
— Ne dites pas cher – dites : onéreux – cher, ce n’est pas commercial.
Bon, je disais que même avec un couteau sous la gorge, je ne l’achèterai pas ce satané produit inutile et onéreux. Parfait, parfait, voyez que je retiens ce qu’on me dit, n’est-ce pas. Et même si je m’en moque de toutes ces règles, même si moi je préfère dire “cher” plutôt que “onéreux”, eh bien je ne le peux pas du tout parce que le couteau, je l’ai bien sous la gorge et je sens la lame froide qui caresse ma peau – mais oui ! C’est le petit nabot à voix portante qui a tendu son couteau froid sous ma gorge alors moi, sans hésiter, je dis “onéreux” et je tartine mes phrases d’“onéreux”, sans aucune retenue et même, je tartine mes phrases de “très bien” – et non pas de “d’accord” – je tartine aussi mes phrases de “je comprends” – parce que l’empathie, je l’ai déjà signalé, l’empathie, ça fait comme qui dirait bien.
Mais plaçons nous en situation.
— Je suis donc X du service client Tralala je souhaiterai parler à…
Là, encore, je m’arrête. Il faut dire : “je souhaite parler” et non pas “j’aurais souhaité” ou bien “je souhaiterai” – ce n’est pas commercial, comprenez-vous.
— Bref, X du service client Tralala, je souhaite parler à Monsieur Duciel. Promotion, offre exclusive etc., vous connaissez la chanson.
— Moui, mon bon monsieur, je suis vraiment désolée mais je n’ai pas d’argent, pas de travail, je reviens de l’hôpital où ma femme vient de mourir après une affreuse et lente agonie, un de mes gamins vient de tomber de la fenêtre, il est plâtré jusqu’au sourcil, mon bon monsieur, je suis désolé et mes cinq autres gamins crèvent la dalle, mon bon monsieur, ils ont le ventre creux comme une noix, ils se tortillent de douleur en réclamant pitance et mère – mon bon monsieur, excusez-moi…
— Je comprends, monsieur. Néanmoins sachez que vous ne pouvez pas vivre sans mon produit parce que bla bla bla.
Et le bon monsieur, veuf et pauvre comme Job va me l’acheter mon produit et moi, je n’ai même pas honte. Je veux dire : je n’ai même plus honte. Avant, bien sûr que j’avais honte, je me morfondais, je ratais mes ventes exprès et je passais mes journées et mes nuits entières rongé du remord le plus amer mais désormais, je n’ai plus de remord, plus de honte. J’agis en éhonté, en toute impunité avec toujours plus de bave sur les commissures des lèvres, les doigts tremblants et les yeux débordant de rage et de fierté.
Après, je me lève, je fais mon coq, je bombe le torse, je relève le menton et je traverse les allées pour me diriger vers le fameux tableau du centre de la pièce. Je me saisis majestueusement d’un feutre et vlan, que je trace un trait précis, net, tout à côté de mon prénom. Et je suis fier comme pas deux ! Mes supérieurs me flattent du coin de l’œil, mes collègues me regardent du coin de l’œil, jaloux jusqu’à la moelle. Et je regagne ma place, tranquillement tandis qu’un sentiment d’inaccessibilité me chatouille le coin de la cervelle et Diable, je me sens intelligent comme pas permis. Vous le croyez, ça, que je me sens subitement intelligent parce que j’ai vendu un satané produit inutile et onéreux à un pauvre hère, veuf et pauvre comme Job ? Bon, moi, cette question, je ne me la posais plus du tout.
Je n’aurais pas brillé longtemps. Le petit nabot à la voix portante se dirige vers moi à coup de minuscules enjambées.
— Ne force pas la vente, me dit-il.
Puis, à toute l’assemblée :
— Ne forcez pas à la vente – mais vendez quand même. Un client forcé est un client qui sera insatisfait – mais vendez quand même. Le client ne doit pas être forcé et doit demeuré satisfait de votre appel – mais vendez quand même. Le client doit garder un souvenir agréable de votre appel – mais vendez quand même.
Je le regarde, hilare. Et alors quoi, vous le comprenez, ça ? Moi, très sincèrement, pas du tout. Il surprend mon hilarité, il croit voir là un symptôme de bonne humeur et il me donne une claque dans le dos.
— Continue comme ça, fais tes ventes, vas-y, tu auras de bien belles statistiques.
Mes statistiques, je m’en moque éperdument. N’empêche, je mets tout en œuvre pour avoir de “belles statistiques” parce que, n’est-ce pas, j’aurais encore plus de claques dans le dos et moi, les claques dans le dos, j’aime bien ça. Bon, le nabot, il va me donner une tape dans le dos, il va flatter ma carcasse et ensuite, il va la piétiner, n’est-ce pas, ça, je le sais, je le sais très bien – alors quoi !
Bon, le petit nabot à voix portante, ratatiné sur lui-même, tout ce qu’il veut, ce sont de belles statistiques. Que les miennes soient belles, c’est un fait mais ce qu’il veut surtout c’est que tout le monde puisse avoir de belles statistiques pour former un ensemble de belles statistiques – et c’est l’ensemble qui compte, voyez-vous – et pour que l’ensemble se tienne debout il faut que tout le monde fasse de belles statistiques. Malheur à celui qui ne tombe que sur des personnes irascibles qui lui raccrochent au nez. D’après mes supérieurs, il y a les “bons vendeurs” et il y a les “mauvais vendeurs”. Etrangement, ils ne prennent jamais en compte ce qu’une de mes collègues appelait le “facteur chance”.
Il y a des clients qui sont tout disposés à acheter votre produit parce que vous appelez au bon moment, parce qu’ils se disaient exactement qu’ils avaient besoin à ce moment là, précisément, qu’ils avaient besoin de ce produit inutile et onéreux. Ainsi, certains, avec beaucoup de chance, pourront faire une dizaine de ventes dans la journée, parce qu’ils auront eu des clients tous disposés, désireux de posséder cet incroyable produit avant même de recevoir notre coup de téléphone. Grâce à ces clients, vous recevrez des tapes dans le dos, votre cou sera flatté et enfin, on dira de vous que vous êtes un “bon vendeur” – avec un peu de chance (mais oui, puisque le “facteur chance” est de votre côté), vous serez ensuite couronné en place publique avec tous vos petits traits à côté de votre prénom.
D’autre part, si le “facteur chance” n’est pas en votre faveur, mais alors pas du tout, vous n’aurez que des clients irrités, insatisfaits dès la première seconde qui n’auront vraiment pas envie de votre produit inutile et onéreux, qui n’auront même pas du tout envie d’en entendre parler et qui, pire, raccrocheront immédiatement leur combiné téléphonique et ces même personnes iront se plaindre au service des réclamations (parce qu’il y en a un, ah, ah, amusant !) qui iront se lamenter et ces lamentations remonteront aux supérieurs et ces supérieurs iront vous botter les fesses en bonne et due forme et enfin, ces mêmes supérieurs vous qualifieront de “mauvais vendeur” et vous vous retrouverez à la porte, sans autre forme de procès.
Alors, avant chaque appel, je croisais fermement les doigts.
Il faut croire que le “facteur chance” ne jouait pas du tout en ma faveur parce que je ne vendais rien. Pourtant, oui-oui, croyez-moi, je lisais mon texte à la perfection, je le connaissais par cœur, jusqu’à la plus petite virgule et vlan que je le déblatérai mécaniquement, sans plus réfléchir tellement il était imprimé dans mon crâne. Il me semblait même que je ne savais plus rien dire d’autre, que ma cervelle s’écoulait par les oreilles et que je devenais une espèce de monomaniaque ou quelque chose comme ça, quelque chose de totalement indéfinissable. Je récitais mon petit texte, ma pièce de théâtre ridicule et… je ne vendais rien, rien du tout ! Alors moi, avec cette constatation évidente en tête, je me suis dit tout bêtement que j’allais un peu dévier, que j’allais adapter mon monologue en quelque chose de plus intéressant, de moins ennuyeux.
— On ne modifie pas Shakespeare m’a-t-on répondu.
Là, je me suis retrouvée désarmée, que répondre à une chose pareille sinon que le petit nabot, celui-là même qui avait déclamé cette phrase hallucinante de stupidité devait bien connaître son sujet.
— Ne soyez pas robotisés, ajouta-t-il ensuite. Ne soyez pas ro-bo-ti-sés mais répétez bien ce qui est écrit à l’écran, ne partez pas en vadrouille n’importe où.
Puis la grande chef, grande comme trois hommes, a fait une irruption dans la pièce, la figure écarlate et a déclamé sur un ton terriblement théâtral, le poing levé :
— On vous de-man-de d’être bê-te et di-scipli-né !
Elle n’a pas dit que ça, elle a aussi un déblatéré son monologue ardent, mais alors avec fougue et même avec humour pour adoucir les angles comme on dit, messieurs. Et cet humour, n’est-ce pas, il était là pour adoucir les angles mais aussi pour vous adoucir, n’est-ce pas, saleté d’humour, pour que vous pensiez que la grande chef est votre amie, qu’elle ne vous veut pas du mal, oui-oui et tout ça, pour mieux vous poignarder dans le dos, ensuite. Et tout en pensant ça, bizarrement, je me sentais d’une clairvoyance folle, d’une intelligence hors norme comme si j’étais le seul à déceler le rouage enrayé – amusant, n’est-ce pas, comme si je pensais être entouré de crétins finis. Et ça, n’est-ce pas, penser que j’étais toujours entouré de crétins finis, ç’a toujours été ma faiblesse parce que j’ai toujours sous-estimé les gens, je me suis toujours cru comme au-dessus d’eux, d’une quelconque façon et même, que j’étais porteur d’un message non pas céleste, mais provenant d’une toute puissance. Pis que ça, je pensais même que j’étais une sorte d’incarnation personnifiée de l’intelligence, quelqu’un à part qui comprenait tout, quelqu’un comprimé dans la masse des gens qui ne saisissaient rien. Et ça, très sérieusement, j’en étais fermement et intimement persuadé depuis l’âge de 5 ans. Mais vous savez, à force de sous-estimer les gens alentour jusqu’à sous-estimer le monde entier et à considérer le monde entier comme un seul crétin fini à l’immense œil creux et globuleux, eh bien, messieurs, vous savez, cet immense crétin fini, il y a bien un moment, il va se jeter sur vous et vous dépecer, n’est-ce pas. Ce n’est pas une science exacte (je ne vois d’ailleurs pas pourquoi je parle de science ici-bas !) mais c’est une théorie qui se réalise à coup sûr. Et ce coup sûr, je l’affirme. Et ce coup sûr, bien évidemment que je l’ai subi – et même, je l’attendais, mon coup sûr. Mais vraiment, tout ça, c’est une autre histoire.
Passons.
Comme l’obéissance est une puissance (ça, n’est-ce pas, j’en ai déjà parlé) eh bien j’ai obéi et je n’ai plus chercher à adapter mon monologue en fonction de mes humeurs. Et je suis devenu bête et discipliné.
Je n’ai pas vendu plus.
Lorsque je ne vendais rien, lorsque mon prénom était désespérément désarmé et lorsque la journée s’achevait, je me levais honteusement de ma chaise, rougissant comme pas permis et j’avais cette impression désagréable d’avoir mille regards accusateurs dirigés sur ma nuque – une simple impression, une impression stupide. Moi-même je trouvais cette impression stupide mais bon, je ne pouvais pas m’empêcher de l’émettre.
Et puis, qu’est-ce que ça pouvait me faire, à moi, de ne rien vendre ? J’obéissais, je répétais inlassablement mon monologue et je ne vendais rien – était-ce pas faute si personne ne voulait de ce crétin de produit inutile et onéreux ? Oui, très sérieusement, est-ce que ma nullité totale en vente devait m’affecter à ce point ? je veux dire : moi, je faisais mon travail, je faisais ce qu’on me disait de faire et je le faisais à la lettre alors vraiment, est-ce que je devais me torturer pour quelque chose qui ne dépendait pas de ma volonté ? J’étais un employé soumis dans son insoumission, j’étais obéissant, j’appliquais les règles à la lettre et je ne dérogeais jamais alors vraiment, est-ce que je pouvais m’en vouloir et est-ce que mes supérieurs pouvaient également m’en vouloir ?
Oui, ils m’en voulaient parce que je frisais des résultats proches de la nullité, du zéro, bref, c’était le néant et mes statistiques n’étaient pas belles du tout ce qui signifiait par extension que les statistiques du groupe entier étaient laides et ce, par mon unique faute. Être bête et discipliné, c’est bien, ça prouve votre obéissance mais ça ne change rien aux résultats.
J’ai déjà dit que je vendais aux pauvres gens, que les seules gens qui achetaient mes produits exclusifs, en série limitées, c’étaient les pauvres gens… Peut-être bien qu’ils les achetaient pour se débarrasser de moi, parce qu’ils n’avaient pas la volonté suffisante pour dire “non” ou bien pour me raccrocher au nez.
Et que ça vous fasse bien pitié, que vous puissez sentir que votre corps entier, jusqu’au moindre petit vaisseau, que tout votre corps est infesté par la pitié jusqu’à trouver un meurtrier désolant ou bien attendrissant. Et que vous ayez bien honte de votre geste, que la honte vous martèle jusqu’à l’épuisement le plus total.
De la honte, de la pitié, je n’en avais plus depuis longtemps. On s’habitue à tout, n’est-ce pas, on s’habitue et le pire, c’est qu’on s’habitue avec facilité, comme si c’était quelque chose de tout à fait naturel ; on ne se rend compte de rien, on pensait ne jamais pouvoir s’habituer à quelque chose et en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, voilà que vous être justement habitué à cette chose, et qu’elle vous semble normale, habituelle. L’habitude vous ferait même prendre pour normal les choses les plus anormales, et venir à considérer les pires déviations comme naturelles. Bon.
Les avertissements se succédaient.
— De la vente conseille, mes amis, vous faites de la vente conseille ! clamait le petit nabot à tout bout de champs en ce promenant entre les allées. Il s’a-git de ven-te con-seill-e – on conseille, on ne force pas à la vente – alors vendez ! Et plus vite que ça !
Sachez que je n’avais toujours pas parfaitement saisi ni assimilé ce beau paradoxe. C’était peut-être pour cette raison que j’étais un si “mauvais vendeur”. Bon, petite parenthèse pour dire que la vente, moi, je m’en moquais vraiment, mais alors vraiment et tout ce que je voulais moi, c’était une petite paie à la fin du mois.
Et ma paie honteusement gagnée était uniquement utilisée pour calfeutrer mes dettes innombrables. Ensuite, je n’avais même plus de quoi me payer un café à la terrasse du bar le plus sale, le plus miteux qu’il soit, c’est vous dire !
Ainsi, je disais que les avertissements se succédaient.
Les superviseurs rodaient, faméliques, entre les allées et sentaient, avec leurs narines énormes, les mauvais vendeurs, ils les traquaient, respiraient sous les semelles, comptabilisaient le nombre de ventes dans la journée, dans la semaine, dans le mois, faisaient de savants calculs incompréhensibles et crachaient ensuite leur sentence, sans équivoque :
— Mauvais vendeur !
— Piètre vendeur !
— Hallucinant de nullité !
— Un pauvre cafard qui ne sait rien faire !
— Un imbécile qui n’a que ses pieds en guise de cervelle !
Ces juges-là étaient sans pitié – et les jurés étaient encore pires !
Ils faisaient demander mes collègues un par un – mes collègues sortaient et… personne ne réapparaissait ! Ils étaient appelés dans un coin, à l’abris des regards et étaient étouffés, vidés, sans que personne ne se rende compte de quoi que ce soit. Puis le cadavre flasque était fichu à la porte, d’une façon malpropre au possible, avec juste sa culpabilité de “mauvais vendeur” en guise de paie – et sans autre forme de procès.
La salle se désemplissait à vue d’œil et j’attendais mon tour avec effroi et anxiété. Les gens tombaient lentement, un par un et chaque jour, une nouvelle tête disparaissait, abattue dans un coin et étouffée vilement, impunément. Je sentais le souffle affamé de mes supérieurs qui glissait dans mon cou, qui était proche, tout proche, juste derrière – l’ombre terrible, omniprésente, qui n’attendait qu’un pas de côté pour m’emmener dans un coin et m’étouffer.
Pour parer l’attaque, pour repousser loin le souffle nauséabond, je m’armais d’une frénésie artificielle et d’un enthousiasme stérile et je tentais de devenir encore plus bête et encore plus discipliné – et mon satané produit inutile et onéreux, je le vendais, finalement. J’écrasais les pauvres gens, je les forçais à acheter mon produit exclusif, à tarif préférentiel, en série limitée etc.
Dès qu’un client me résistait, je grognais de colère, je mugissais et j’effrayais les faibles gens.
Peu importait la méthode, je les faisais mes ventes alors le souffle nauséabond s’en est allé un peu plus loin, lui et son ombre détestable.
Lorsqu’on essaie de faire une vente, il ne faut surtout pas mentir. A ce propos, personne ne ment. Mais tout le monde occulte. C’est ainsi. C’est révoltant, c’est indigne, certes. Néanmoins, sans ça, personne ne vendrait. Il ne suffit pas d’être gentil, de sourire aux insultes, d’avaler les méchancetés, de détourner l’agacement, il faut aussi occulter tout ce qui peut l’être – et ce, sans pitié, sans trouble de la conscience. Dès que la conscience est troublée, c’en est fini et vous êtes définitivement catalogué “mauvais vendeur”.
Et moi, par souci de conscience, par souci d’amour propre (oui, oui, seulement ça), je ne voulais absolument pas être catalogué définitivement “mauvais vendeur”. Si on m’avait demandé de nettoyer tous les caniveaux du monde et de le faire à plat ventre, je l’aurais fait consciencieusement, au mieux – simple question d’amour propre, pour être ensuite félicité de mon travail et pour qu’on admire mon zèle. Parce que moi, juste, ce que je voulais, c’était briller auprès de mes supérieurs même si, je le répète encore, même si j’avais ce système hiérarchique en horreur et qu’il me donnait de l’urticaire.
Moi, j’étais juste fier dans ma soumission. Bon, ça, j’imagine, c’est assez incompréhensible.
Peu importe.
Avant, alors que j’essayais de vendre mon produit inutile et onéreux, je pensais qu’il était difficile d’être sincère et persuasif alors que je savais pertinemment que le produit que j’essayais de refourguer était justement inutile et onéreux. Par la suite, j’ai compris et je devins d’une hypocrisie digne de la pire ordure que la terre puisse porter.
Parce que mon produit inutile et onéreux devint un produit indispensable et très peu onéreux (parce que cher, je le rappelle, il fallait le bannir du langage).
Et il fallait que j’en sois moi-même fermement persuadé pour pouvoir persuader mes clients – et que mes hypothétiques clients deviennent des clients tout court. Il fallait que je pense moi-même que le produit que je proposais m’était indispensable et que je pouvais l’obtenir par une somme ridicule. Je le fus – j’aurais même plus l’acheter, ce produit indispensable et très peu onéreux.
Le client hypothétique pouvait résister, je l’écrasais quand même. Je ne me fiais plus aux voix traînantes, pleurnichardes, je n’avais plus pitié de quoi que ce soit ni pour qui que ce soit, j’assommais les pauvres gens avec mes affirmations dogmatiques et les pauvres gens faiblissaient, s’arc-boutaient et… acceptaient. Ils finissaient tous par accepter ! Je dis tous, mais je mens. Il y en a bien qui ont résisté, qui ont paré vaillamment mes attaques fielleuses et violentes, qui se sont distingués du reste de la population par leur volonté ferme.
Parce que les gens qui faiblissaient, ces tristes gens qui achetaient finalement mon incroyable produit indispensable et très peu onéreux, ces gens là avaient une volonté de la taille d’une cerise. Et moi, sans pitié et sans remord, je m’insinuais dans la faille de leur volonté défaillante, je l’essorais, la retournais, l’écrasais – et vraiment, croyez-moi, je réussissais ! Quelqu’un qui a une volonté affaiblie accepte tout, tout, et sans rechigner, voyez-vous.
Quelqu’un qui avait une volonté ferme, puissante, indestructible me mettait dans une rage folle, aveuglante. Les personnes qui ont une telle volonté savent dire “non” mais des “non” qui vous retournent la cervelle et moi, je ne voulais plus jamais entendre de “non”, les “non”, voilà, me mettaient dans une sale petite colère mesquine d’enfant capricieux. J’aurais pu en venir à frapper le sol du pied en pleurnichant, en hurlant, en criant et me tortiller sur ma chaise comme si on m’avait arraché mon hochet des mains et ça, très sérieusement. Face à un refus direct, ferme et indiscutable, je levais les bras, je braillais comme un forcené dans mon petit micro – mes doigts se crispaient, mes muscles se tendait frénétiquement, mon poing tremblait et la sueur dégoulinait le long de mes tempes.
— Quoi ? Madame Ducervô, il ne vous intéresse pas mon produit in-dis-pen-sable ? Pourtant il est indispensable, abordable, un va-nu-pieds pourrait se l’offrir, madame Ducervô ! Alors, quoi, qu’est-ce qui ne vous plaît pas ?
— Non.
— Madame Ducervô, écoutez-moi. Ce produit indispensable et à coût abordable, il coûte tant en magasin. Sortez de chez vous, allez voir au magasin du coin, vous verrez que cet incroyable produit est hors de prix, terriblement coûteux et que mille va-nu-pieds ne pourraient pas se l’offrir, même en cotisant leur milliers de centimes, madame alors quoi ? Profitez, profitez, madame ! Demain, peut-être bien qu’il sera trop tard, madame Ducervô, écoutez bien ce que je vous dis !
— Non.
— Pardonnez-moi madame ? Vous souhaitez en bénéficier de ce produit, c’est bien ce que vous avez dit ?
— Non.
— J’en suis ravi, madame Ducervô, ravi, madame ; je prends donc note de votre accord, madame. Vous souhaitez bien bénéficier de ce produit indispensable (série limitée, tarif préférentiel etc.) ? Excellent choix madame !
— Non.
— Eh bien, madame Ducervô, vous êtes bien une femme ?
— Oui.
— Vous vous appelez bien Ducervô ?
— Oui.
— Vous êtes bien mariée à monsieur Ducervô ?
— Oui.
Il s’agit là de la “règle des trois oui” qui est indispensable, parait-il. Bon, voilà, je l’applique, comme tout “bon vendeur” ; j’applique les règles à la lettre, j’obéis et voyez-vous, je suis bête et discipliné.
— Alors, madame Ducervô, ce produit indispensable (série limité, tarif préférentiel, offre exclusive), vous le prenez, n’est-ce pas ?
— Non.
Moi, moi, je bous de colère, je sens mes veines qui gonflent, prennent de l’ampleur, je suis fou de rage.
— Alors quoi ? Tu vas le prendre mon produit, salope !
Bon, ça, je l’ai crié fort – peut-être un peu trop fort – parce que tout le monde m’a entendu et toutes les têtes se sont retournées, en un seul mouvement frénétique, toutes les têtes se sont retournées dans ma direction et tous les yeux sont restés braqués sur moi.
— Alors quoi ? je cris encore en dévisageant toutes les têtes une par une, alors quoi, qu’est-ce que vous me voulez, tous ? Est-ce qu’il y a un problème, est-ce qu’il y a un problème, n’est-ce pas ? Est-ce que j’ai dit quelque chose qui ne vous a pas plu ? Madame la Salope n’a rien entendu puisqu’elle avait déjà raccroché !
Rassurées, les têtes se sont toutes détournées de moi pour plonger à nouveau dans leur écran.
Bien sûr, moi, j’avais menti, madame la Salope avait tout entendu – mais quoi, il fallait bien que je mente sinon toutes les têtes m’auraient dévisagé encore et encore et alors moi, je n’aurais rien pu faire et rouge de honte d’être ainsi dévisagé, je me serais enfui en courant, honteux. Simple question d’amour propre, messieurs, je ne supporte pas d’être dévisagé de la sorte. Mes supérieurs n’ont pas bronché, ils ont eux aussi détourné la tête – ils me respectaient, désormais, parce que j’étais devenu un “bon vendeur” et qu’ils n’avaient absolument rien à redire à un tel fait.
Bon, j’étais encore sous l’emprise de la rage la plus indécente qu’il soit parce que j’avais raté une vente. Et même si j’étais devenu le meilleur vendeur, même si les supérieurs vantaient mes nombreux mérites et se servaient de moi comme modèle, je n’en demeurai pas moins agacé d’avoir laissé filé une cliente. Je sentais mon visage brûlant qui rougissait de honte et cette petite honte de rien du tout s’insinuait par tous mes pores pour contaminer mon corps entier, jusqu’au moindre ongle, au moindre cheveux et tout ça, ça me rendait fou de colère ! Et, croyez-le ou non, je considérais la madame Salope comme unique responsable.
Je décidai de la rappeler.
— Madame Ducervô, malheureusement, suite à un problème technique, la ligne a été brutalement coupée.
(Là aussi je mentais, bien sûr que c’était elle et elle seule qui avait créé le “problème technique”)
— Ainsi, madame Ducervô, je crois que vous souhaitiez ardemment bénéficier de mon offre exclusive, n’est-ce pas ?
— Non.
— Mais… madame, ce produit est le meilleur dans sa catégorie. Moi-même, j’en ai acheté dix, madame, dix, tous beaux, avec un tarif préférentiel, hallucinant, madame. En magasin, j’aurais certes pu m’en offrir un – mais un, ça ne suffit pas ! Au même prix, j’ai pu m’en offrir dix, madame.
(Encore, oui, je mentais encore et comme un arracheur de dents)
— Comprenez-vous madame, qu’il faudrait être fou pour passer à côté d’une telle offre.
— Non.
(J’essayais de me contenir comme je le pouvais, je grinçais méchamment des dents)
— Madame Ducervô, est-ce que cela signifie que vous êtes folle ? N’est-ce pas ?
— Non.
— Je ne vous comprends pas, madame ! Vous êtes folle, vous êtes actuellement en train de faire passer la chance de votre vie, madame !
— Non.
— Alors, madame, peut-être bien que vous bénéficiez actuellement d’un vocabulaire très restreint, peut-être bien que vous ne savez dire qui “non” – et accessoirement, de temps en temps, un petit “oui” riquiqui ? (et moi, c’est surtout le “oui” qui m’intéresse).
— Non.
— Donc, madame, si je comprends bien, vous ne souhaitez pas bénéficiez de mon produit (série limitée, tarif préférentiel, offre exclusive etc.), c’est bien ça, madame Ducervô ?
— Oui.
— Parfait madame ! Je prends note de votre oui-oui ; vous recevrez votre produit indispensable (série limitée etc.) dans les deux jours qui suivent, madame.
— Non.
— Comment ça, non, madame ? On ne peut pas changer d’avis ainsi, madame ! Madame, votre indécision me laisse perplexe, madame. Changer d’avis comme ça, madame, mais vous souhaitez me tourner en bourrique ? Me prenez-vous pour un imbécile madame ? Madame, vous m’avez dit “oui”, “oui” à mon produit (série limitée etc.) alors quoi madame, il faut s’en tenir à votre “oui”, madame, vous n’avez donc aucun respect pour vous-même, madame Ducervô ?
Je frappais la table du poing. Il n’y eut plus aucune réponse, elle avait raccroché. De colère grondante, je m’arrachai les cheveux par poignées.
— Ah ! mais quelle vieille saleté ! grognai-je, pour moi-même, faiblement, pour ne pas que les têtes alertes m’entendent.
Je décidai alors de la rappeler.
— Madame Ducervô, encore un petit problème technique, fort heureusement, j’ai noté votre numéro. Je ne voudrais pas vous voir passer à côté d’une telle opportunité. Vous savez, des opportunités pareilles, madame, bon, quoi, il y en a une dans sa vie, une seule, une unique. Bon, parfois, il y en a peut-être deux mais ça, madame, c’est rare, terriblement rare. Alors sautez donc sur l’occasion, ne laissez pas la chance de votre vie s’échapper comme un vulgaire rat de…
Je parlais dans le vide, comme on dit. La bougresse avait raccroché.
Je tentais de la rappeler – elle ne décrocha plus son combiné.
Furibond comme je ne l’avais jamais été, je bondis sur mes pieds en crachant dans tous les coins – bien évidemment, tout le monde se retourna et cette fois-ci, le petit nabot à voix portante se dirigea vers moi, l’œil ensanglanté et la mine défaite.
— Qu’est-ce qu’il se passe ici, encore ? demanda-t-il.
Qu’il me demande ce qu’il se passait, ça, je m’en moque – j’aurais fait la même chose. Mais qu’il ajoute un “encore” me mit hors de moi. Certes, j’étais déjà hors de moi – cependant, là, je crois que je devins vraiment effrayant.
— De quoi ? fis-je, faussement interloqué, de quoi – quoi ? De quoi ? Je ne comprends pas. Vois-tu, j’essayais de vendre mon produit, vois-tu ? Eh bien, une madame m’a violemment raccroché au nez, vois-tu ? Hein ? Et moi, je n’avais rien demandé.
— Bon, on entend que toi, on t’entend depuis l’autre bâtiment, tu cries, tu cries – il ne faut pas crier. Tu parles à des clients, tu ne parles pas à ta femme…
— Quoi ! je n’ai pas de femme ! rajoutai-je.
— Bon. Tu est un très “bon vendeur”, tu es même le meilleur. Tu sais très bien qu’être un “bon vendeur” signifie aussi que tu dois accepter les échecs. On ne te demande pas de vendre à chaque personne que tu as au téléphone…
— Mais quoi ? Mais si ! Mais si !
— Peut-être que tu n’as pas bien compris le principe.
— On me dit de vendre alors je vends, moi ! grinçai-je entre mes dents.
— On ne te demande pas d’être ro-bo-ti-sé.
— Ah ! Mais je le sais, ça !
Vraiment, je me contenais, je me contenais, j’essayais du mieux que je le pouvais.
— Alors, ajouta le petit nabot, essaie de te tenir correctement, tu dois le respect au client – c’est aussi lui qui te nourrit, ne l’oublie pas. Et n’oublie pas non plus que tu fais de la vente conseille…
— Dans vente conseille, il y a vente.
— Un “bon vendeur” sait être à l’écoute.
— Mais je suis un “bon vendeur” ! m’exclamai-je.
— Un “bon vendeur” ne force pas à la vente.
— Ah ! Mais il faut savoir, alors !
J’avais crié un peu fort – par ailleurs je savais que j’étais épié de tous les côtés depuis le début de la conversation, ma tête brûlante m’indiquait que je rougissais fortement et ça, ils avaient tous dû le voir, c’était certain.
Le petit nabot ne savait plus quoi dire. Je vendais, je faisais mes ventes, je faisais beaucoup de ventes alors il ne savait plus quoi dire. C’était grâce à moi que les statistiques étaient belles et qu’elles étaient en hausse. Trop peureux pour ses belles statistiques, il ne dit plus rien et partit, les oreilles basses.
Quant à moi, je décidai de rappeler madame Ducervô. Je réessayai dix fois de suite – et ce, sans aucune réponse. Elle ne décrocha plus du tout. Acharné comme j’étais je voulais à tout prix continuer.
Mais un autre obstacle se mit en travers de ma détermination.
Une autre superviseur, une petite bonne femme énergique, très jeune se dirigea vers moi, tranquillement, suivit de la chef, grande comme trois homme et de deux autres sbires. J’ai vu l’étrange convoi arriver de loin, de très loin et jamais je n’aurais pu penser qu’ils se dirigeaient tous vers moi – je me considérais trop comme qui dirait… irréprochable. Ça, oui, je l’ai dit, je me considérais comme le petit employé parfait, celui qui obéit à la lettre, sans même poser la moindre question, sans même rechigner – même si on me confie la pire tâche sur Terre.
Et voilà qu’un étrange convoi, un convoi d’hallucinés se dirigeait vers moi, avec une cadence tranquille, sereine mais alors d’une tranquillité douteuse comme trop… je ne saurais dire. Vous savez, une de ces tranquillités qui cache une espèce de malaise sous-jacent, un malaise terrible, un secret, quelque chose, je ne sais pas – mais alors quelque chose de vraiment terrible.
Un sbire posa sa main rêche sur mon épaule et la resserra jusqu’à me faire tressaillir. Je me retournai pour le regarder droit dans les yeux et pour dévisager mes hôtes un par un.
— De quoi ? fis-je bêtement au bout d’un moment puisque personne ne se décidait à parler.
Je dis “bêtement” parce que j’ai vraiment été bête et je me suis senti, à cet instant précis, bête comme je ne l’avais jamais été, aussi bête que je considérais mes collègues bête – je me suis senti comme je les considérais moi-même. Et ma réplique, je crois, elle ne convenait pas du tout à la situation. Et ça, que ma réplique n’était pas la bienvenue, ça, je le savais avant même de la déclamer bêtement – mais voyez, je l’ai quand même déclamée. Bref.
Ma réplique bête souleva un tonnerre. Je veux dire : bien sûr que le tonnerre était déjà là, sinon, le petit convoi n’aurait même pas pris la peine de se déplacer jusqu’à moi, mais ce que je signifie, c’est que ma réplique déplacée, peut-être trop audacieuse, engraissa le tonnerre déjà grondant. Comme tout bon tonnerre, la foudre finit par s’abattre.
— Est… est-ce… est-ce que vous sa-vez ? déclara très tranquillement la chef (dois-je encore préciser qu’elle était haute comme trois hommes ?)
Elle ne bégayait pas, elle parlait avec lenteur, elle épelait, prononçait chaque mot non pas avec difficulté mais avec une très grande concentration ; elle était studieuse avec la prononciation de n’importe quelle mot, elle ouvrait grand la bouche et faisait des mouvements élastiques de mâchoire, elle s’appliquait terriblement. Bref, elle articulait chaque mot d’une manière démesurée.
Trop d’années de télémarketing, ça vous laisse des traces physiques, des espèces de tics détestables qui ne vous lâcheront plus jamais – je dis cela parce que madame notre chef avait été, je cite platement : “une ancienne téléactrice qui avait grimpé les échelons”. Bon, on nous disait ça comme pour nous faire croire qu’il y avait un certain avenir (un avenir tout à fait relatif, n’est-ce pas), qu’il y avait un avenir dans ce secteur. Moi, les échelons, je m’en moque. Plus je suis bas et mieux je me sens. Être tout en bas, c’est sans risque ; on se fait un peu piétiner, un peu maltraiter mais on s’y habitue et on finit par aimer terriblement tout ça, on finit par aimer le sol et tout ce qui est bas, très bas (ou tout ce qui est en dessous). Bref.
Moi, juste, après, j’ai répondu :
— De quoi ?
Et j’étais encore plus interloqué. Bizarrement, elle a cru que je me moquais d’elle parce que je répondais toujours tout aussi bêtement, que j’avais les yeux gros comme des poings etc. ; j’ai aussi senti la main du sbire se resserrer encore plus fermement sur mes os. Je me sentais de plus en plus bête, tout en répondant bêtement, je me traitais d’idiot de répondre de la sorte. Bien sûr, j’aurais aimé paraître intelligent et déclamer une réplique intelligente qui les aurait fait tomber à la renverse. Bien sûr, ça, je n’en suis jamais capable ; dès que je veux dire quelque chose de vraiment intelligent, c’est toujours une stupidité innommable qui sort de ma bouche – pourtant, vraiment je suis intelligent, ça, je le sais ! Eh, quoi ! J’ai encore répondu un troisième “de quoi ?” ! Ah ! mais être imbécile à ce point, je me demande comment c’est possible !
Le problème, je ne l’imaginais même pas. Mais voici ce qu’il en fut.
Le fait était que de nombreux clients mécontents avaient appelés le “service des réclamations”. Bon, des clients mécontents qui appellent le “service des réclamations”, il y en a toujours cependant, là, il y en avait plus que d’habitude, ce qui a alerté jusqu’au chef suprême de la société (qui se trouvait alors dans la capitale). Bon, les autorités suprêmes mandatés par le chef suprêmes ont enquêté, ils ont remonté la piste pour connaître le fautif et il s’avérait que j’étais le fautif, mais alors l’unique fautif et que j’avais, à moi tout seul, inondé le service de réclamations de réclamations hargneuses en tout genre.
Bon, moi, j’ai été étonné d’entendre tout ça, je n’en croyais pas mes oreilles et je répétais mes “de quoi ?” bêtes comme pas possible ; je crois même que je n’étais pas capable de dire autre chose.
— Vous… vous com-prenez mon-sieur, dit la chef haute comme trois homme, vous com-prenez que… que nous ne pou-vons to-lé-rer une telle chose ici, mon-sieur.
— De-de-quoi ?
Je la trouvais stupide, cette femme qui faisait des efforts insurmontables d’articulation, ces mimiques étaient comiques, terriblement comiques – personne ne s’en rendait compte ou quoi ? Je n’étais tout de même pas le seul à avoir remarquer une chose aussi flagrante ! Comment pouvais-je prendre une telle femme au sérieux ? Comme pouvais-je, très sérieusement, avoir du respect pour cette femme ? Peut-être bien qu’elle était intelligente, peut-être bien qu’elle avait de l’esprit, mais sa mâchoire désarticulée nous offrait à voir le parfait contraire : une stupidité innommable. Moi, je me disais que le visage ne mentait jamais. Elle maniait la sophistique à la perfection (je viens de le dire, ça, que le télémarketing vous laisse des tics détestable, n’est-ce pas) – mais à mes yeux, ça n’était nullement une preuve d’intelligence. Après, là, je le sais moi-même, on peu instaurer un débat du genre : mais quoi une preuve d’intelligence, d’où est-ce qu’il y a des preuves de l’intelligence etc. Mais cela, voyez vous, nous mènerait directement dans un labyrinthe. Or moi, je préfère m’abstenir.
Bref, la chef au visage élastique et stupide en avait après moi. Un deuxième petit sbire avait posé sa main sur mon autre épaule, celle qui était libre et tous les deux, ils m’ont soulevé ainsi et ils m’ont transporté jusque dans un bureau, précédé du reste du convoi, et le tout, mon Dieu, sous les nombreux regards du public alentour. Les humiliations publiques, je les accepte sans broncher tout en ressentant poindre au fond de mon âme une honte inexpugnable qui demeurera à jamais comme une saleté de petit morceau d’ordure, qui demeurera coincé là-haut, dans un coin du crâne – et tout ça, je le sais d’avance, je ne pourrai plus jamais m’en débarrasser de ce petit morceau d’ordure de rien du tout. Et je me souviendrai jusqu’à la fin des temps de toutes mes humiliations en place publique et le sentiment de honte toute puissante qui s’abattit sur moi durant ses instant précis demeurera intact et frais et virulent, même dans mille ans.
C'est-à-dire, en quelques mots, que tous les yeux s’étaient déjà braqués sur moi depuis l’arrivé de l’étrange convoi et les yeux ne m’ont plus quitté, ils ne se sont plus détachés de moi – et ça, vraiment, pour moi, rien que pour moi, c’est déjà une humiliation, d’être dévisagé impunément par des dizaines de paire d’yeux. Mais le pire, messieurs (et peut-être mesdames), le pire, écoutez donc, ce que je ne supporte pas, c’est de passer pour un imbécile devant ces dizaines de paires d’yeux ! Si j’avais déclamé une belle réplique intelligente, toute pleine de fioritures, vraiment, l’honneur aurait été sauf mais mes “de quoi” bêtes n’ont rien sauvé à l’affaire.
Et voilà qu’on me traînait comme un pauvre chien, qu’on me tirait par les deux épaules à travers les allées d’yeux et que chaque œil était attentif au moindre détail et chaque œil avait dû voir l’épis qui se dressait dans mes cheveux, celui que j’avais toujours essayé de camoufler sans succès et chaque œil avait dû apercevoir la tache sur le bas de mon pantalon (l’unique pantalon que je possédais) et chaque œil avait dû bien rire avec sa paupière grasse qui clignait idiotement. Moi, j’étais humilié jusqu’à l’estomac, j’essayais de plaquer ma main sur ma tête pour tenter de dissimuler mon épis et j’essayais de plaquer une autre main sur mon pantalon pour tenter de dissimuler les taches ; mais des taches, il y en avait bien trop, c’était comme impossible et j’en venais à me trouver idiot et ridicule – jusqu’à trouver idiot et ridicule la tenue que j’avais mise ce jour-là. Et tout ça, juste à cause de ces dizaines d’yeux. J’en venais à regretter d’avoir mis cette chemise idiote et ridicule !
Bref, les yeux me faisaient prendre pleinement conscience de mon statut de misérable absolu. J’avais juste envie de fuir même en sachant que je ne me débarrasserai jamais de toutes ces sensations immortelles qui me transperçaient alors de part et d’autre. Néanmoins, sans ces yeux, j’aurais pu me sentir à l’abri, un peu, juste un peu.
Dans le bureau isolé, on me fit asseoir sur une chaise et tous se placèrent face à moi, en ligne.
— Nous ne pou-vons to-lé-rer un tel compo-o-o-rte-ment, mons-ieur, dit la chef.
Les deux sbires et la supérieure approuvèrent d’un mouvement de tête. Puis, comme la chef ne voulait pas des mauvais rôles, elle lança un clin d’œil rapide à la supérieure qui fit un pas en avant en cachant ses mains dans le dos.
— Nous nous trouvons donc dans l’obligation de… nous nous voyons donc obligés de… nous nous trouvons dans la situation pénible qui fait que nous… que vous…
— A-llons ! cracha la chef.
— Nous nous voyons donc dans l’obligation de nous séparer de … de vous séparer de nous… de vous… nous…
— De quoi ? fis-je encore, bêtement.
Et Diable, très sérieusement, je ne savais plus dire autre chose.
— Vous remplissez vos objectifs, renchérit-elle, un peu plus sûre d’elle, malheureusement, à notre grand dam (et nous allons déplorer votre présence), vous allez devoir nous quitter (mais… nous déplorerons votre présence etc.), tu vas devoir nous quitter…
— De quoi ?
— Nous ne faisons pas de la vente forcée mais de la vente conseille. Il faut certes vendre mais il ne faut pas forcer, tu le sais. Tu vas salir nos belles statistiques, nous ne pouvons pas accepter une telle chose.
— Mais (je pouvais donc parler !), mais… je suis X du service client Tralala et ma place est ici !
— Ta place n’est plus ici puisque tu as failli et nous frôlons la mauvaise réputation, et ce par ton unique faute.
— Mais… de quoi ? on me dit de vendre et j’ai vendu, j’ai rempli mes objectifs, il y a eu de belles statistiques grâce à moi… Le client Tralala…. X… le service… mais moi… quoi…
— Ce n’est pas du bon travail. C’est du très mauvais travail. Tu es malheureusement un “mauvais vendeur”.
Un sbire chuchota quelque chose à la supérieure et cette dernière de rajouter rapidement :
— Tout à fait. Psychologique – le test psychotechnique, peut-être bien… peut-être bien que vous devriez le repasser…
Moi, bien sûr, en temps normal, j’aurais ri sous cape parce que j’avais triché à ce satané test, n’est-ce pas mais là, je me sentais comme piqué de fierté, à tel point que je me disais que je n’avais nullement triché, jusqu’à être persuadé de mon propre mensonge.
— De quoi-quoi-quoi ?
Là, je le savais, mes yeux avaient triplé de volume.
— De quoi le test psychomachin ? rajoutais-je en bafouillant terriblement…
Tout ça, le bafouillage, les yeux gros comme des ballons, je crois que c’était juste pour me donner un genre, pour faire bien, parce que ça fait bien de bafouiller, de rougir un peu, tout ça, tout ce petit théâtre, petite comédie, ça fait bien et moi, je me disais que ça ferait un peu pitié. La pitié, je détestais ça, plus que tout, je méprisais la pitié mais alors terriblement pourtant, souvent, je rabattais la pitié à moi et je m’en servais comme d’un allié honteux – ça, pour être honteux, ça l’était !
Que dire ! La pitié, ils devaient tous la mépriser autant que je la méprisais ! Parce que mes gros yeux, mon bafouillage, mes joues rouges, eh bien ça ne les a même pas fait tressaillir ! Pas un battement de cil ! Pas un pli sur le front ! Pas de vague sur la bouche ! Rien de rien je vous dis !
— Peut-être… le test psychotechnique, le repasser, il faudrait, continuait la supérieure sans trop savoir elle-même où elle se dirigeait. Une très bonne note, vous aviez eu une très bonne note – on pourrait vous garder pour votre test mais là. C’est impossible, monsieur, comprenez-vous ?
Non. Je ne comprenais rien.
N’empêche, j’ai acquiescé bêtement.
— Très bien, j’ai dit.
— Et tu vas devoir nous quitter.
— Très bien ; je comprends
— Au revoir.
J’avais abandonné. J’étais le pire homme que la terre pouvait porter – ça, c’est que je suis me suis dit sur l’instant. Car tout en voulant répliquer à coup de phrases intelligente, tout en pensant ça, je me suis levé, compréhensif et j’ai fait une petite courbette ridicule. Et tout ça, en pensant le contraire ; comprenez-vous ?
— Je vous remercie pour votre accueil chaleureux et je vous souhaite une excellente journée, ai-je dit.
Pour récupérer mes affaires, j’ai dû retraverser la grande salle avec toujours les dizaines de paires d’yeux qui étaient encore braqués sur moi. Cette scène, je n’ai toujours pas pu l’oublier et je la revis tous les jours, avec douleur et haine, je vis avec ces yeux fixes, je dors avec ces yeux fixes et ils me suivent, ils ne me lâchent pas d’une semelle, ils demeurent perpétuellement braqués sur moi, sur ma nuque, derrière moi, ils sont derrière, ils sont là, ils ne partiront pas, ils ne partiront jamais.
J’ai quitté la salle, la tête basse, la mâchoire serrée jusqu’à briser mes dents.
Par la suite, j’ai encore essayé de téléphoner à madame Ducervô. Si vous ne suivez pas, bon, relisez les lignes qui sont au-dessus. Madame Ducervô, j’ai essayé de la rappeler, je le jure ; je ne voulais pas rester sur un échec aussi stupide. Comment dire… Il le fallait, voilà tout. Il faut s’y faire, à mes voilà tout, parce que tout s’explique par des voilà tout ou bien par des comme ça. Et parfois, il ne faut pas voir plus loin, n’est-ce pas. Néanmoins, une fois encore, je vais m’abstenir.
Moi, je suis un homme à “échecs”. Pas de calembours stupides merci. Les échecs, avant, ils ne me dérangeaient pas du tout et pire, je les aimais, j’aimais cette sensation gênante qui s’ensuit, cette petite perte de l’amour propre, cette incision dans le cœur et moi, exprès, je provoquais les échecs, exprès pour ressentir cette incision au coin du cœur.
Mais là… c’est comme si je ne pouvais pas accepter cet échec stupide ; il me restait sur le cœur, pesant, lourd, lourd, terriblement lourd et il écrasait le corps entier et vraiment, je savais que je ne pourrai plus jamais regarder quelqu’un en face avec cet échec stupide devant les yeux.
Alors la madame, je l’ai rappelée, encore, d’une cabine, de chez moi, de n’importe où, encore, toujours, encore, sans cesse parce que je ne voulais pas cesser. On ne m’a jamais répondu.
Je crois moi-même en mes stupidités ; on m’a dit que j’articulais d’une façon stupides, que je baragouinais des choses incompréhensibles, que j’avais les yeux vaporeux, on m’a dit que je marchais comme un singe, plié en deux, les mains traînantes, on m’a dit que j’avais l’air grave, que je sursautais au moins bruit, à la moindre sonnerie téléphonique.
On a même dit que j’étais fou.
Voyez, je l’avais dit dès le début.
Alors, messieurs et peut-être mesdames, vous en pensez quoi, vous ?
Moi – rien. Je n’en sais rien ; je ne sais rien. Je ne suis même plus capable d’aligner deux mots sans plonger dans une réflexion intense.
Travaillez ! Il paraît qu’il le faut messieurs (et peut-être mesdames), travaillez ! Et puis le travail, n’est-ce pas, c’est la santé. Alors quoi, de bon cœur messieurs etc., de bon cœur, les yeux grands ouverts, les oreilles attentives, messieurs – puisqu’il faut y aller.
Et puis, sans ça, messieurs, mais il paraît que c’est la mort assurée. Alors quoi ? – de bon cœur, je l’ai dit, messieurs !
On verra bien, n’est-ce pas ? |